Comte Zéro, de William Gibson
Quatrième de couverture :
Turner est le meilleur dans sa partie, les opérations d’exfiltration. Le dernier casse informatique de Bobby, jeune et intrépide hacker new-yorkais surnommé Comte Zéro, a mal tourné et le système qu’il croyait pirater est en train de le tuer.
Après « Neuromancien », William Gibson poursuit ici son exploration du cyberespace et des étendues urbaines.
Cyber-voodoo-space
Deuxième tome de la « trilogie Neuromantique » (ou « trilogie de la Conurb » selon le nom que l’on veut bien lui donner), « Comte Zéro » partage bien des points communs avec le premier volume, « Neuromancien ». Appartenant bien évidemment au cyberpunk, écrit à l’époque (1986) où le genre s’abreuvait de toutes sortes de technologies émergentes pour inventer un futur fait de transformations cybernétiques, de navigation dans un cyberespace informatique alors à l’état de fantasme geek, de dominations des mégacorporations sur les états, un futur violent, socialement déliquescent, un futur sale, « Comte Zéro » capitalise sur son illustre prédécesseur tout en faisant un pas de côté.
Ou plutôt un pas vers l’avenir puisque « Comte Zéro » se déroule sept ans après les évènements de « Neuromancien ». William Gibson change de technique narrative pour articuler son roman autour de trois personnages apparemment indépendants les uns des autres. Le premier, Turner, est un mercenaire chargé d’exfiltrer un ingénieur désirant fuir la mégacorporation qui l’emploie pour en rallier une autre. Le deuxième, Bobby, est un jeune et inexpérimenté hacker (au surnom de Comte Zéro) qui, en utilisant dans le cyberespace un brise-glace qu’il a loué (un programme censé « casser » des défenses informatiques, classiquement pour infiltrer une structure informatique dans laquelle on cherche à récupérer fichiers et/ou informations), se retrouve à deux doigts de mourir, sauvé in extremis par une étrange apparition. La troisième, Marly, est une ancienne propriétaire de galerie d’art à Paris qui se retrouve chargée par un milliardaire de retrouver le créateur d’étranges objets d’art.
A partir de là, William Gibson nous amène avec ces trois personnages dont les chemins vont bien sûr se croiser (du moins pour Turner et Bobby, Marly restant un peu à part même si son intrigue a une forte résonnance avec les deux autres), toujours dans sa manière un peu obscure, hachée, faite de non-dits et de petits « flash » descriptifs dressant pour le lecteur une atmosphère et une ambiance typiques du cyberpunk avec les décors qui vont bien, qu’ils soient urbains ou sociaux, vers une vérité qui prend une tournure à la fois proche et différente de celle de « Neuromancien ». Il y est forcément question d’IA qui, cette fois, semblent vouloir faire un peu plus que simplement intervenir dans le cyberespace (avec apparitions virtuelles, à l’aide de « montures humaines », de dieux vaudous), alors qu’en parallèle un personnage humain a la possibilité d’interagir avec ce même cyberespace sans la nécessité d’utiliser une console de connexion.
A partir de tout cela, l’auteur nous plonge entre un thriller d’espionnage (pour ce qui concerne Turner), un récit technologique (pour en arriver à ce que Bobby comprenne le pourquoi du comment de ce qui lui est arrivé), et une enquête sur fond artistique (pour Marly à la recherche du créateur d’oeuvres d’art bien particulières), trois fils narratifs aboutissant à quelque chose plus grand que la somme de ses parties. On touche donc à de nombreux thèmes résolument cyberpunk (le cyberespace bien sûr, les IA, sur fond de transhumanisme) tout en garnissant le roman de ce qui, sans constituer une partie majeure de l’intrigue, donne une vraie substance au décor (arcologies, « réparations » biologico-cybernétiques, urbanité tentaculaire, dérégulation sociale, faillite des états, toute-puissance des mégacorporations, gangs, etc…).
Pour l’amateur du genre cyberpunk des origines (les années 80 essentiellement), « Comte Zéro » est un vrai plaisir de lecture, en un certain sens plus limpide que « Neuromancien » (même si le décryptage du roman demande un peu de réflexion, notamment sur la fin), mais sans le rush narratif, le flash d’adrénaline qui le caractérisait (et son casse dans le réel comme dans le virtuel). La variété narrative de « Comte Zéro » est un plus et même si l’on met du temps avant de commencer à faire le lien entre les trois intrigues, les trois personnages ont suffisamment à offrir pour garder constamment l’attention du lecteur.
Une belle réussite donc pour ce « Comte Zéro » qui peut se lire de différentes manières : aussi bien au premier degré pour une aventure techno-cyber-artistique typique de sa période d’écriture, que comme une lecture « patrimoniale » sur un avenir que nous prédisait le cyberpunk des années 80 (et qui, sur plusieurs plans, n’est pas totalement éloigné de la réalité), dans un style typiquement gibsonien. Tout le monde n’y trouvera peut-être pas son compte (le style et l’univers du roman sont tellement marqués qu’il faut sans doute un minimum d’affinités avec l’un ou l’autre avant de s’y attaquer, sans oublier que la lecture préalable de « Neuromancien » est un petit plus non négligeable), mais il mérite encore toute l’attention des lecteurs, notamment avec la nouvelle traduction de Laurent Queyssi qui a encore fait un travail tout à fait pertinent.
Lire aussi l’avis du Chroniqueur.


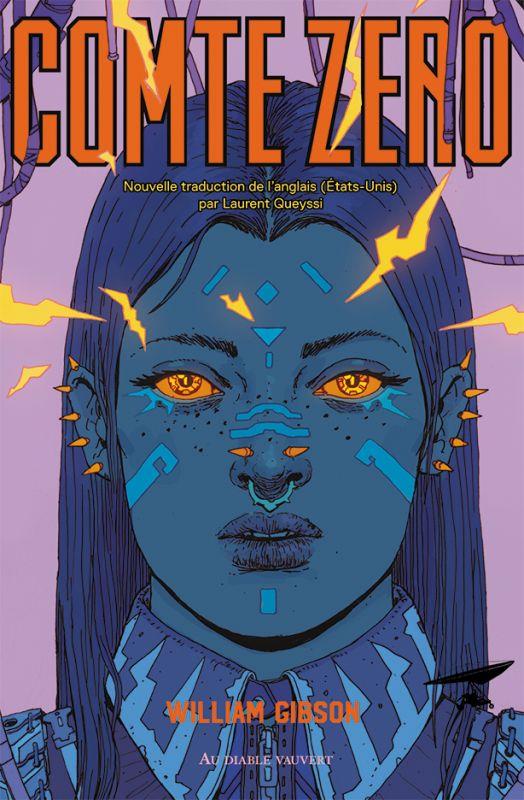
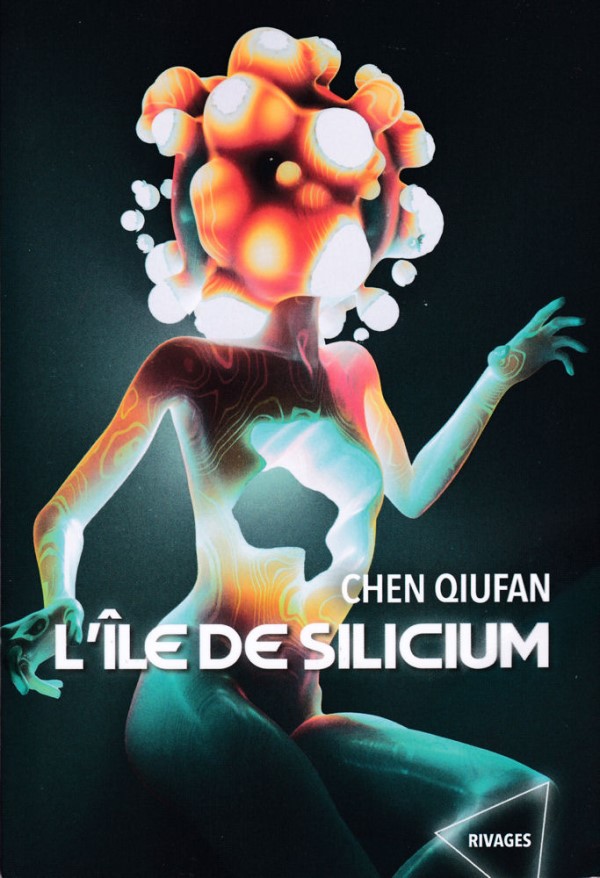
Il faut vraiment que je me lance dans cette série qui manque à ma culture SF/Cyberpunk
Avec cette nouvelle traduction, ça (re)devient un vrai plaisir.
Mais ceci dit, pas sûr que le style de Gibson convienne à tout le monde… 😉